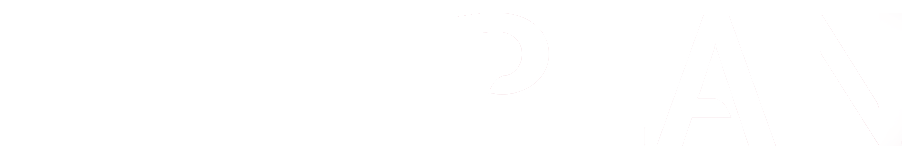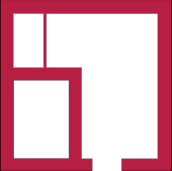Une extension de maison consiste à agrandir une construction existante en créant de la surface habitable supplémentaire attenante au bâtiment d’origine. Contrairement à une construction neuve non juxtaposée, elle fait partie intégrante de la maison principale à minima par son usage. La structure peux être totalement indépendante, mais parfois elle partage un mur, une toiture ou un plancher commun.
Pour être reconnue comme une véritable extension, elle doit répondre à certaines conditions. D’abord, elle doit être réalisée sur un terrain déjà bâti. Ensuite, elle doit respecter les règles d’urbanisme locales — notamment le Plan Local d’Urbanisme (PLU) — qui fixe les limites de hauteur, d’emprise au sol, de retrait par rapport aux limites séparatives et les obligations liées au stationnement ou à la végétalisation. Enfin, elle doit rester en continuité avec le bâti existant : une pièce isolée dans le jardin, même habitable, est considérée comme un nouveau logement ou une construction annexe, pas comme une extension.
Selon la surface créée, le type de travaux et la zone du projet, les démarches administratives diffèrent. En dessous de 20 m², une simple déclaration préalable de travaux suffit la plupart du temps. Au-delà de ce seuil, un permis de construire devient obligatoire. En zone urbaine (zone U) couverte par un PLU, le seuil de la déclaration peut être porté à 40 m², à condition que la surface totale du logement ne dépasse pas 150 m² après agrandissement. Dans ce dernier cas, le recours à un architecte est obligatoire.
L’extension d’une maison peut prendre plusieurs formes : agrandissement latéral, surélévation, création d’une véranda. Elle permet de gagner en confort tout en valorisant le patrimoine immobilier. Mais pour être réussie, elle nécessite une étude précise du bâti existant, des contraintes du terrain, et une analyse technique et réglementaire menée par un professionnel.